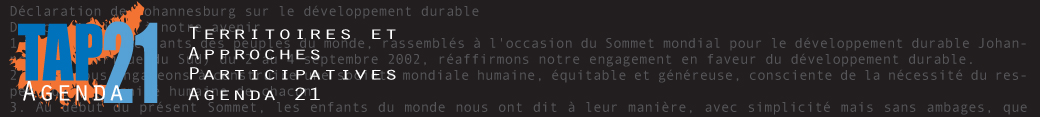2. Normes affectives et travail émotionnel au sein des arènes de la participation
Etudier les dimensions émotionnelles des formes d’engagement des publics dans les assemblées reviendra à tirer parti des précieux apports des approches ethnographiques de la participation (Cefaï et al., 2012). Les postures descriptives qui caractérisent ces dernières, en effet, permettent de restituer au mieux, non seulement les aspects strictement discursifs des interactions, mais encore les dimensions non-verbales, les gestes, les mimiques, les tonalités de la voix et autres indices témoignant de corps affectés. Ce faisant, ces approches empiriques s’avèrent indispensables afin de mettre à jour les normes qui régissent les modalités d’expression manifestement tenues pour légitimes au sein des publics rassemblés. Loin de se réduire aux prescriptions visées par les ingénieurs de la participation (voir supra), ces normes affectives trahissent souvent la prégnance des cultures civiques propres aux contextes étudiés (Berger, 20012 ; Tawa-Lama, 2015).
Les communications pourront ainsi s’attacher à décrire dans quelle mesure la justesse de la participation dépend de la capacité à exprimer des émotions jugées convenables, voire obligatoires (Mauss, 1969). En d’autres termes, il convient ici de repérer des systèmes d’émotions — aussi bien prescrites que proscrites — qui servent de points d’appui aux montées en généralité, aux déclarations d’allégeance à des identités collectives, à la désignation des portes paroles les plus légitimes, etc… Dans cette perspective, les manifestations d’indignation, de réprobation, voire d’hostilité, qui résultent de la transgression des conventions en vigueur offrent souvent des indicateurs précieux des attentes qu’elles commandent habituellement. De fait, l’observation empirique gagnera à être attentive aux situations de désajustement, aux montées en tension, aux rappels à l’ordre de ceux qui ne s’émeuvent pas conformément aux normes dont dépend la bonne intégration au collectif (Paperman, 1995).
Par ailleurs, l’encadrement procédural qui caractérise la démocratie participative dicte de prendre en compte la manière dont la sociologie du travail s’est emparée de la question des émotions. A ce propos, on ne peut ignorer l’apport essentiel de l’œuvre d’Arlie Hoschild (Hoschild, 2003). La sociologue américaine, en effet, a démontré à quel point, au sein de nombreuses professions, la gestion de ses propres émotions, ainsi que de celles d’autrui, constitue une compétence professionnelle à part entière. Loin de se contenter de relever l’existence des émotions prescrites au travail, l’analyse se doit alors d’examiner les procédures et les processus d’apprentissage d’un « travail émotionnel » consistant à moduler ses états affectifs conformément aux exigences propres aux métiers. Dans une telle perspective, les communications pourront interroger dans quelle mesure l’animation ou la simple participation à des dispositifs de la participation impliquent l’acquisition de savoir-faire spécifiques lorsqu’il s’agit d’exprimer des émotions tout en s’efforçant de peser sur celles du public. Quelles sont les techniques mises en œuvre indispensables pour récuser l’indifférence fatale à toute participation ? Quelles aptitudes ces techniques exigent-elles ? Un jeu superficiel (surface acting) ou un jeu en profondeur (deep acting) ? Quelles formes d’apprentissages, ou organisation des rôles, exhortent les professionnels de la participation à trouver une bonne distance visant à leur éviter d’être pris dans des situations affectives intenables ?
3. Les émotions et le débordement des dispositifs institutionnels
D’une manière très générale, l’une des propriétés cruciales des effets des dispositifs institutionnels est de ne jamais totalement se réduire à ceux escomptés par leurs concepteurs. De fait, loin de pouvoir se contenter d’interroger les intentions stratégiques à l’origine de leur élaboration, l’analyse commande également de saisir les multiples formes d’appréciation et d’appropriation dont ils peuvent faire l’objet de la part de publics qui ne demeurent jamais de simples cibles passives. Ainsi de nombreux travaux consacrés à la démocratie participative ont souligné l’importance des processus de débordement des dispositifs institutionnels par des réactions et des conduites qui échappent aux anticipations et aux contrôles des ingénieurs de la participation. La perspective de ce colloque invite, par conséquent, à examiner dans quelle mesure l’expression de certaines émotions contribue grandement à alimenter ces dynamiques de débordement.
Dans quelle mesure les discours et postures ironiques des participants manifestent-ils des formes de défiance qui, en dépit de leur faible intensité, peuvent s’avérer déterminantes dans la dynamique des concertations (Barbier, 2005) ? Comment à travers les accusations de « mépris » lancées contre les autorités (Cefaï, Lafaye, 2001) certains publics s’efforcent-ils parfois de prendre le contrôle de la concertation à laquelle ils ont été conviés ? Le thorubos — le tumulte des participants — ne permet-il pas aux publics les plus nombreux de contourner les modes d’expression et les procédures imposées par les experts de la participation (Cossart, Talpin, Keith, 2012) ? D’une manière plus générale, les montées en tension liées à l’expression des émotions ne facilitent-elles pas les entreprises visant à ouvrir « un débat sur le débat » (Fourniau, 2007) ? Dans le cadre des controverses, les contre-expertises formulées pour récuser les projets des autorités ne sont-elles pas d’autant plus performatives qu’elles impliquent des connotations affectives qui n’échappent pas au public ? On pourra également examiner la manière dont l’enchaînement des phases de la concertation peut susciter des états affectifs alternatifs qui suscitent le trouble et la démobilisation des publics rassemblés. Comment, par exemple, des attentes enthousiasmantes peuvent être suscitées puis déçues par le zèle procédurier des maîtres d’œuvre de la participation ? Une perspective plus particulièrement centrée sur le vécu subjectif évolutif des participants pourra également examiner dans quelle mesure l’expérience affective, inattendue et éprouvante, qui résulte de la participation à des dispositifs tels les jurys citoyens peut inciter certains individus à renier les rôles distribués par les ingénieurs de la participation (Barbier, Bedu, Buclet, 2009).